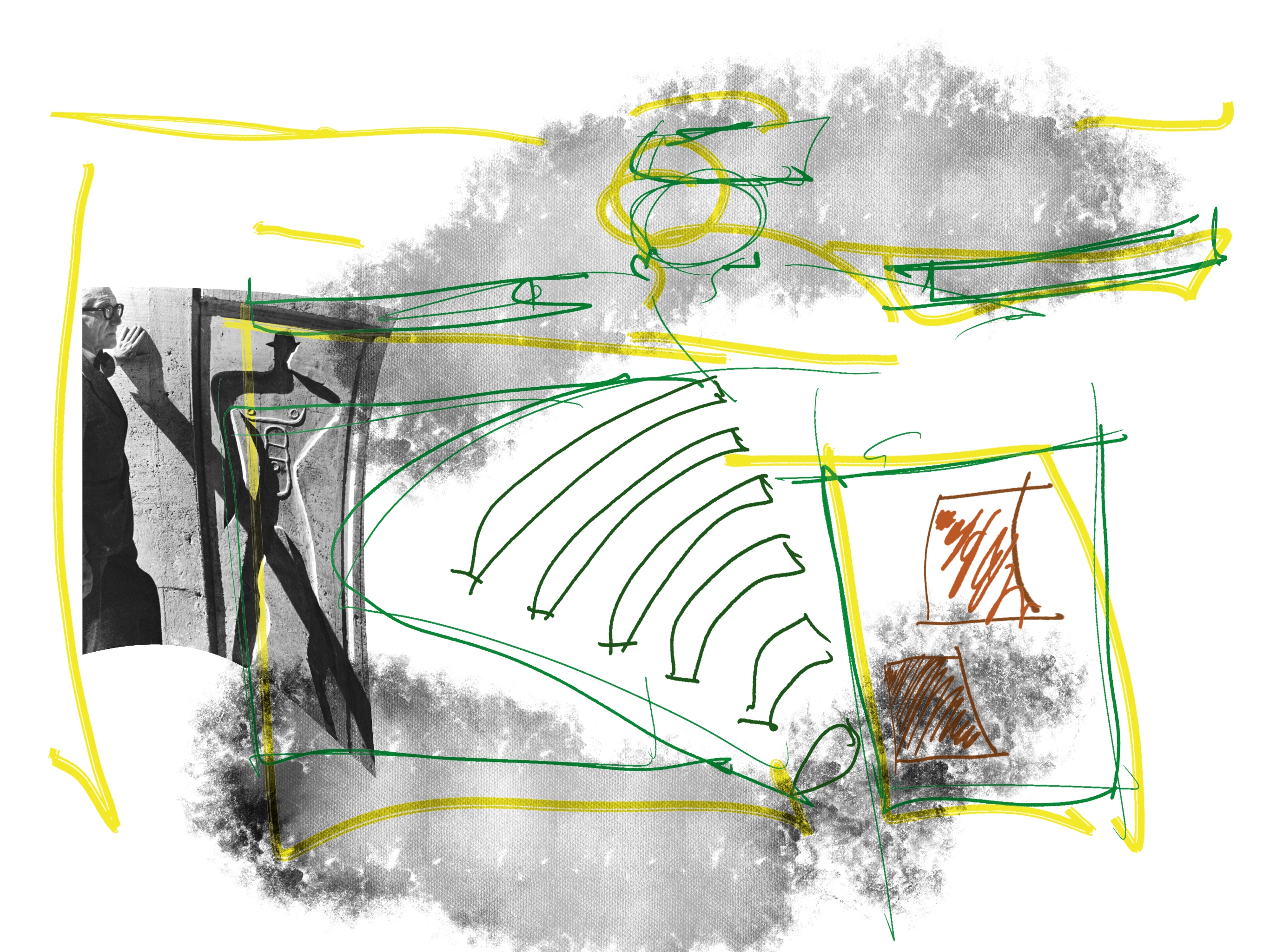Gustavo Lins, Lïns Paris, 2021

Robe pull illustrée
par Gustavo Lins, 2021
La rencontre avec Gustavo Lins est personnelle. On se connaissait
déjà, professionnellement, mais on s’est croisé à un cours de yoga, dans
le Marais, juste après le premier confinement. Très vite, on a pris
l’habitude de se retrouver autour d’un café après le cours. À l’écouter
parler de son parcours, de son métier, de ses influences, j’ai eu envie
de l’interviewer, de coucher sur le papier un petit peu de la richesse
de son expérience. Et puis il y a eu le deuxième confinement. Malgré ses
réticences numériques, Gustavo a accepté qu’on se retrouve sur Zoom
pour un long échange. J’ai édité un peu ses réponses, lissé çà et là
quelques phrases, mais j’ai peu coupé, pour ne pas assécher la richesse
de son propos. On était en pleine pandémie, on avait le temps de lire et
l’envie de se faire du bien.
Je suis né à Belo Horizonte, au Brésil, dans une famille de 9 enfants. Mon père était chirurgien. Depuis tout petit, j'adorais passer du temps avec lui, il me montrait ses planches d'anatomie. Il m'expliquait comment fonctionne le corps humain et il me disait : “si tu veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, sache comment fonctionne ton corps“. Donc depuis tout petit, j'étais habitué à voir ces dessins de l’anatomie du corps humain, de la musculature… Ensuite , il y a eu la natation. J'ai commencé à nager à l'âge de 9 ans. Je suis devenu un très bon nageur, j’ai fait de la compétition. J'étais un enfant extrêmement anxieux, mon père pensait que la natation me ferait du bien. Le rapport à l'eau est resté un truc très fort. Et puis, il y a eu le cheval. Mon oncle avait une magnifique propriété à l'intérieur du pays. On y allait pendant les vacances. On faisait du cheval tous les jours. J’ai été très tôt familiarisé avec l'animal, avec son environnement, le cuir, les selles… La construction de la selle, j'y reviens toujours.
Je me souviens que nos vêtements étaient fabriqués à la maison. Il y avait un atelier de couture où une couturière venait régulièrement. Une bonne couturière venait pour ma mère et mes sœurs. Une autre dame venait pour nous, les garçons, mais j'étais rarement content du résultat. J'étais toujours frustré par la réalisation. Le vêtement, pour moi, c’ était une fascination, et aussi une source d'angoisse. Nous étions d’un milieu assez favorisé et, à l’adolescence, alors qu’on commençait à sortir, les jeunes portaient des vêtements de marque que je ne pouvais pas avoir et j'ai développé un certain rejet par rapport aux vêtements. Moi, j’avais mon uniforme: un pantalon kaki, un t-shirt bleu et mon maillot de bain. C’était tout. Plus tard, quand je suis rentré à l'école d’architecture, je gagnais très bien ma vie, j’avais pris un job à mi-temps dans une banque d'affaires. La première année, j'ai littéralement grillé mon salaire en vêtements idiots. Des vêtements de marque brésilienne. J’ai fini par me rendre compte que c'était une grosse connerie: non seulement ces vêtements étaient mal coupés mais ils étaient très chers pour ce que c'était. Je suis donc revenu aux bonnes vieilles méthodes. J'ai acheté une pièce de lin et une de laine froide, je suis allé voir un tailleur pour mes pantalons et une couturière pour mes chemises. Quand je suis allé en classe avec, mes copains et mes copines voulaient absolument m'acheter ce que je portais. J’ai trouvé ça un peu bizarre au début mais j'ai accepté de vendre une de mes chemises à un ami. Ça a commencé comme ça. Jusqu'au jour où une copine m’a encouragé à devenir styliste de mode. Pour moi, ce n’était pas un métier. Tout le monde faisait ça pour s’habiller. Elle m’a fait découvrir la collection dalmatien de Jean-Paul Gaultier et j'ai eu un déclic. J'ai compris que les vêtements, la mode, pouvait être conçus comme un projet d’architecture et j'ai commencé à dessiner des vêtements. Je dessinais tout le temps des figurines. Quand nous avons du dessiner des perspectives, pour nos projets d’architecture, il fallait y intégrer des personnages en mouvement. J’en faisais des figurines de mode et je suis vite devenu l'illustrateur de la classe. C’est en 3ème année que je me suis rendu compte que c’était vraiment ça que je voulais faire. Mais je devais finir ce que j'avais commencé et passer mon diplôme d'architecte. Parallèlement, j’ai monté un petit business de vêtements. J'achetais du tissu, je coupais les vêtements, j'allais chez la couturière, et je les vendais mais je n’étais pas très à l’aise, je ne connaissais pas les techniques de coupe. Pour moi, c’était un mystère. Je ne savais pas comment faire un patron. J’ai passé mon diplôme en décembre 1986. Je suis parti à Barcelone un mois après. Je ne pensais pas y rester très longtemps mais je voulais faire quelque chose de mon temps là-bas et je me suis inscrit dans un cours de “coupe tailleur“ où je n’ai strictement rien appris. C’était vraiment des recettes de cuisine que je ne comprenais absolument pas. Au bout de 4 mois de bourrage de crâne, le jour où j’ai voulu assembler un vêtement, je n’ai pas su mettre la manche sur le corps et j’ai repris les planches d’anatomie. En observant le corps, le vêtement et le patron tout a pris sens. L’année suivante, j’ai commencé un doctorat d’architecture. Depuis toujours, j’étais fasciné par le Japon et l’architecture japonaise. Je me disais que peut être il y avait un rapport entre le vêtement et l’architecture. Mon maitre de thèse m’a invité à aller voir une boutique dans le haut très chic de Barcelone où j’ai pu voir et toucher des vêtements d’Issey Miyake et d’Azzedine Alaia. J’ai adoré et j’ai commencé à faire un travail qui associait le vêtement et l’architecture. D’Alaia, j’ai retenu le corps, la musculature, le vêtement comme une armure, les coutures en spirale qui suivent la ligne de jointure des muscles. Les muscles ne se rencontrent jamais de façon orthogonale, c’est toujours en diagonale. Issey Miyake, c’était le kimono, l’influence de Madeleine Vionnet. Je me suis dit, mon histoire elle est là : je vais travailler sur l’armure et le kimono. Le kimono est devenu ma marotte. Je prenais des kimonos anciens que je drapais, que je torturais, que je surpiquais.
Au moment de finir mes études à Barcelone, mon maitre de thèse m’a dit: “je ne vous demande pas de faire une thèse académique, scolaire, je vous demande une pratique de coupe. Pour cela, il va falloir travailler 10 ans comme modéliste pour comprendre ce qu’est la construction“. J’ai accepté le défi et quelques mois après, j’arrivais à Paris pour les vacances d’abord et je suis resté. Comme on dit au Brésil, il y a un cheval harnaché qui est passé et je suis monté sur la croupe ! J’ai vu que c’était à Paris que je pourrais vraiment exercer ce métier. Seulement, avant de me lancer dans la création, ne connaissant personne, n’ayant aucune connexion, il valait mieux que j’apprenne d’abord à être un très bon technicien, que je maitrise bien toutes les techniques de couture, pour envisager plus tard la conception. En 12 ans, j’ai travaillé pour plusieurs maisons de couture, comme modéliste, comme ouvrier qualifié, comme chef d’atelier… Et c’est seulement à 40 ans que j’ai décidé qu’il était temps que je raconte ma propre histoire. J’ai monté ma société fin 2002. Je pensais que le Brésil ne m’avait jamais vraiment marqué. Avec le temps, pourtant, je me rends compte que la palette de couleurs que j’emploie est très minérale. Je viens d’une région de mines, le Minas Gerais. La palette des couleurs y est plutôt grise, voire noire. Je suis finalement influencé par ces couleurs sourdes loin du folklore très coloré des tropiques. Là-bas, quand il fait très chaud, l’été, le soleil est tellement fort qu’il grise les couleurs. La nature et toute la gamme des verts deviennent grises, seulement ponctuée de couleurs vives. Jaune, violet… Finalement, je peux dire aujourd’hui que cette culture un peu hybride, 1/3 européenne, 1/3 indigène, 1/3 africaine, est la base de ma personnalité.
J’étais un petit garçon hyper angoissé. J’avais peur de tout. J’avais peur de la vie. J’avais une angoisse qui me rongeait de l’intérieur. Le vêtement aussi était une source d’angoisse parce que c’était un terrain interdit à la maison. On habitait une grande maison avec un jardin qui donnait sur la rue et derrière, il y avait une arrière-cour et il y avait les communs où les femmes de service habitaient et une des chambres était l’atelier de couture dont je parlais tout à l’heure. Nous n’avions pratiquement pas le droit d’y aller. C’était le domaine des personnes qui travaillaient à la maison et c’était aussi un univers très féminin. J’étais à la fois effrayé et fasciné par ce monde. J’étais un garçon hyper solitaire. Hyper maladroit. Quand on devait jouer au foot, j’avais un mal fou avec la coordination des mouvements de mes pieds. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas attraper le ballon avec les mains. Comme j’étais très mauvais, on m’a mis comme ramasseur de ballon. Ça ne m’allait pas du tout. Heureusement, j’ai commencé à nager. Cela me convenait bien mieux, un sport individuel !
J’ai été un excellent élève et comme la plupart des bons élèves, j’étais très angoissé par l’école. J’avais de très bons résultats et j’ai été totalement autonome dès l’âge de 10 ans. Je n’avais besoin de personne pour m’aider. Mais il y avait ce sentiment d’abandon et de solitude profonde malgré ma nombreuse famille (16 personnes vivaient sous le même toit). Il y avait toujours beaucoup de monde à la maison mais j’étais hyper isolé.
Non ma mère a eu 10 grossesses, je suis la 7ème grossesse mais le 6ème enfant (elle en a perdu un). Après moi, il y en a eu 3.
Dans notre milieu social, on croisait des gens très très riches. Mon père avait une situation très confortable, très privilégiée, mais il avait quand même 9 enfants à charge, inscrits dans des écoles privées. Il y avait beaucoup de réceptions, de mariages… Ma mère était très débrouillarde. Elle s’était constitué des “uniformes“. Quand on allait dans ces soirées, j’observais que toutes les autres femmes portaient des robes brodées, des drapés… Ma mère ne s’habillait pas comme ces femmes-là. Elle considérait que pour avoir une robe drapée, il fallait avoir un très bon couturier, qui sache le faire, sinon on avait l’impression de porter un rideau de douche, que la broderie pouvait être vite vulgaire, vous faisant ressembler à un sapin de Noel. Elle préférait porter des choses plus strictes. Elle avait quelques bijoux (à chaque fois qu’elle avait un enfant, mon père lui offrait un bijou, donc elle en avait 10). Et avec ça, elle faisait son mix. Elle inventait. Elle prenait un chapeau, elle enlevait le bord, elle retournait la calotte. Elle décousait une robe… Elle se débrouillait. C’était une femme très douée et elle avait une bonne couturière. Je trouvais qu’elle avait raison d’aller vers cette sobriété, avec cette recherche de ligne, de silhouette, plus que d’effets. Mon père, qui était un esthète, ne l’a jamais contrariée. C’était un couple qui fonctionnait bien. Ils étaient très amoureux, ils avaient une admiration mutuelle. Mon père comprenait parfaitement comment un vêtement était cousu. Il allait chez son tailleur faire faire ses costumes et il savait quand un vêtement était mal coupé, quand il tombait mal. Comme je l’ai dit plus tôt, la couture était une activité très présente à la maison. J’avais 4 soeurs. Il y avait 4, 5 ou 6 mariages par an et, chaque fois, il fallait habiller toute cette troupe. Je pensais que nous étions les cousins pauvres parce que nous n’avions pas les moyens de porter ce que les autres portaient mais quand j’ai commencé ce métier, je me suis rendu compte de l’importance de l’éducation que j’ai reçu: “less is more“. Très peu d’effet et les couleurs qu’il faut maitriser avec beaucoup de sagesse. En dépit des conflits et des différents que j’ai pu avoir avec ma mère, elle m’a beaucoup appris. À l’age de 10 ans, à la fin de l’école primaire, c’était la mode du tie & die, elle avait fait quelque t-shirts pour mes soeurs et pour ses amies. On avait des cousines fortunées qui avaient trouvé ça intéressant et lui avaient passé commande. Elle en a fait un petit business. Moi, j’étais tout le temps collé au fourneau pour mélanger les couleurs. Elle m’avait appris les formules qu’elle connaissait et m’avait envoyé chez un allemand qui avait une droguerie en centre ville où il vendait des pigments de très bonne qualité. Il m’a montré comment faire la gamme de couleurs, m’a appris les différentes combinaisons, d’autres formules, les dosages, les temps de prise… J’ai fait ça pendant 3 ou 4 mois. J’allais 2 fois par semaine acheter des pigments et des tissus. Je partais en bus et je revenais à pied pour économiser l’argent du bus. Avec l’argent que j’ai gagné, j’ai pu partir en vacances 3 semaines, je me suis acheté une montre, une paire de raquettes de tennis de plage et un ballon en cuir. C’est la première fois que j’ai vraiment travaillé. À 10 ans, j’avais compris ce qu’était le travail et qu’on pouvait gagner sa vie avec ce qu’on aimait faire. Ça a été une expérience très forte de mon enfance. J’étais très complexé par rapport à mes frères plus âgés. Ils avaient plus de panache. J’ai toujours vécu dans leur ombre. Il m’a fallu beaucoup de temps pour me libérer de cette enfance. Les études m’ont sauvé. Et le sport. Je pouvais nager 10 km par jour.
Dans cette famille très traditionnelle, les garçons pouvaient faire médecine pour être de préférence chirurgien, faire du droit pour être dans la haute magistrature, ou ingénieur des ponts et chaussées. À 17 ans, je passais mon bac et les concours des grandes écoles, mais je ne me voyais dans aucune case. J’ai opté pour ingénieur des mines. Je pensais à tort que cela pouvait être un peu plus drôle que les Ponts & Chaussées. J’ai intégré l ‘école et ça a été un vrai cauchemar. J’ai craqué. Une fois de plus, mon père est intervenu. Il m’a dit: “Quand je vois ta calligraphie, je suis certain que tu peux dessiner“. Il m’a apporté quelques livres de dessin et je me suis mis à dessiner. J’adorais ça. Il m’a orienté vers l’architecture, ça lui semblait un bon compromis. Mais bon, je n’étais plus dans le peloton de tête. J’ai préparé le concours d’architecture que j’ai eu sans trop de problème et ça m’a libéré. J’y ai rencontré des personnes beaucoup plus libres, plus drôles, qui avaient plus ou moins rompu avec leurs familles bourgeoises et traditionnelles. Parallèlement, j’ai passé un concours pour un job dans une banque d’état. Je gagnais très bien ma vie et j’habitais encore chez mes parents. J’avais presque 16 salaires par an car nous dépendions de la bourse qui allait très bien à l’époque et on pouvait faire des placements. C’était les années 80. Quand je pense au Brésil, même encore aujourd’hui, j’ai des poussées d’angoisse très forte. Il y avait beaucoup de violence, une brutalité, dans ce pays qui ne me donnait pas envie d’y vivre.
L’Europe c’était le grand fantasme des anciennes colonies. Dans l’inconscient collectif, il y avait une espèce de nostalgie d’un monde révolu. Le milieu dans lequel je vivais était très europhile. Les gens y lisaient le français couramment ou étaient très attirés par la France. Mes tantes, mes grand-tantes, voyageaient tout le temps. Je me rappelle les avoir accompagnées au bateau. Elles partaient pendant 2 mois, elles traversaient l’Atlantique, elles restaient 2 mois sur place et quand elles revenaient, il y avait une odeur particulière quand on ouvrait les malles et les cadeaux. Depuis tout petit, j’avais envie d’aller là d’où elles revenaient. Les États-Unis ne m’ont jamais attiré alors que ma génération voulait vivre le rêve américain. Moi, j’écoutais ce que mes tantes me racontaient des villes comme Paris, Londres, Rome… Il y a toujours eu ce fantasme européen. Mes parents étaient extrêmement orientés vers la culture européenne.
Mon travail, c’est une recherche d’une géométrie euclidienne (le carré, le rectangle, le triangle, le cercle) dans les courbes que l’on retrouve dans la nature. Le meilleur exemple, c’est quand tu regardes un jardin japonais à vol d’oiseau. Tu vois les pans des toitures, des pans rectangulaires, des rectangles coupés par des triangles que l’on appelle les pans des eaux. Et autour, les jardins avec des formes très organiques. C’est un mélange de la ligne et de la courbe. Le cercle pour moi reste une ligne et la spirale, une ligne en 3 dimensions. Pour ce qui est du persona, après 17 ans d’expérience en création, je me pose la question: est-ce qu’il y a quelqu’un, un persona, qui pourrait illustrer ce que je fais? Je commence à voir des bribes d’intuition. Ce n’est pas encore clair. L’idée de l’homme est très précise pour moi: c’est un homme hybride, libre, qui a traversé les âges. La question de la femme, je ne sais pas trop parce que je suis encore très perturbé par cette image de ma mère qui m’a beaucoup impressionné mais qui m’a aussi fait beaucoup de tort pendant mon enfance et mon adolescence. C’est un modèle féminin qui m’a fasciné mais qui m’a aussi terrorisé. Le modèle masculin est plus clair. Mon père était un homme très doux, très intelligent, très perspicace. Il ne me mettait pas du tout en danger. Ce que je fais par rapport à la mode est très psychanalytique. C’est vraiment la théorie freudienne: le père et la mère. Et je suis en plein milieu et je ne sais pas de quel côté pencher. Peut être que, maintenant, je sais qu’il ne faut pencher d’aucun côté. Il faut rester au centre, inébranlable, quoi qu’il arrive. Et laisser la tornade tourner autour. C’est peut être ça la conclusion de toutes les analyses que j’ai pu faire depuis l’âge de 19 ans. La conclusion c’est ça, il ne faut pas se laisser impressionné par la périphérie, il faut rester au centre. Je crois aussi que l’identité n’est pas unique, elle peut bouger tout le temps. Il n’y a pas un homme et il n’y a pas une femme. Nous-mêmes, en tant qu’être humain, nous sommes plusieurs personnes tout au long de notre existence. Je ne suis plus aujourd’hui la même personne que j’étais à 30 ans. Je crois que quand on fait ce métier de la mode, c’est très important de laisser le persona vieillir. On ne peut pas figer comme certains couturiers le font, parce qu’ils ont, je pense, une relation œdipienne très forte avec leur mère. Ils figent leur mère dans l’histoire de leur vie et passent leur temps à rechercher cette image. Moi, c’est tout le contraire. La mère pour moi, c’est l’épouvantail qui m’a fait aller vers des choses plus évoluées.
Il y a quelqu’un que j’aime beaucoup, c’est Jean Prouvé. La manière dont il fait les meubles et son travail à l’Observatoire de Paris. De temps en temps je regarde les solutions de détails de ses meubles, comment le bois est coupé… Charlotte Perriand est aussi très présente dans mes créations. Mais peut être que la plus forte influence c’est Giorgio Morandi. Rien que d’y penser, j’ai les larmes aux yeux. Il a su magnifiquement exprimer les heures de la journée, la lumière. Il prend toujours les mêmes éléments, le même beurrier, les mêmes carafes, les mêmes tasses… Ce sont toujours les mêmes objets vus à des moments, des saisons différentes, avec des lumières différentes. C’est d’une subtilité, d’une beauté qui est très difficile à exprimer à travers des collections de vêtements où on est obligé de changer tout le temps, d’apporter des nouvelles formes. J'aime chez Morandi cette constance du sujet et cette inconstance de la lumière. Ces deux paramètres rendent son œuvre unique. Il est très présent chez moi, mais pas de manière formelle, c’est l’inspiration profonde. Sinon, l’Espagne et surtout la culture du flamenco. La musique, les costumes, le monde des gitans, Garcia Lorca, Manuel de Falla. Cette musique me met en transe. Quand je vois les volants s’envoler, ça me rend dingue. Quand ils tapent, les “tablado“, tout remonte, j’entre en transe. La gamme de couleur noire que je retrouve chez Velasquez, Goya, Zurbaran… Tous ces peintres du 17ème ou du 18ème siècle espagnol m’ont beaucoup appris et ce grâce a une personne extraordinaire avec qui j’ai travaillé qui était chez Balenciaga avant la fermeture : Juliette Cambusarno. Elle était première d’atelier à l’atelier tailleur. Elle m’a donné plein de pistes pour décrypter le travail de Balenciaga et elle m’avait dit : “la clé majeure est dans la peinture. Il faut voir les tableaux de Goya, de Velasquez, du Greco, pour comprendre Balenciaga“. Et en effet , quand j’ai vu la gamme de noirs, teintés de bleu, de vert, de rouge, j’ai trouvé ça fascinant, comment il a su si bien exprimer la culture espagnole à travers sa mode qui était très austère. Tout sauf drôle. Mais très osée quand il mettait du rose à côté du vert et du noir. C’est quelque chose qu’à l’époque on ne faisait pas en France. Mes influences sont très diverses mais à un moment donné, je fais mon cocktail, le trait d’union restant le kimono japonais. Je l’utilisais entre autre pour dédramatiser la haute couture avec son côté “casual“ : sortie de bain, vêtement pour dormir, vêtement d’apparat, vêtement de cérémonie… ça reste toujours le même patron mais l’image change selon la circonstance. C’est l’histoire du signe et de la sémiotique. Tu as le signe, tu as l’objet et ce qu’il veut dire, ce qu’il représente. C’est grâce au kimono japonais que j’arrive à conjuguer à ma manière toutes ces influences tous azimuts.
Oui c’est vrai. Dans la construction des tableaux de Morandi, il y a une verticalité. C’est encore plus flagrant dans ses dessins. Comment il hachure ses ombres pour découper l’ombre et la lumière, on a de vraies verticales blanches apposées aux verticales hachurées. Et le kimono, c’est une base carrée qui renvoie aussi à la verticalité. Les lignes sont verticales, le col est vertical, les pans sont verticaux, et pourtant quand on mesure une pièce de tissus pour un kimono, on retrouve un module carré en divisant la longueur par la largeur. Ce sont aussi les proportions d’un tatami: 2 carrés, 90x180. Le plan d’une maison japonaise part de tatamis assemblés avec parfois un carré au milieu de la pièce, c’est l’élu du foyer. C’est là où l’on fait chauffer l’eau pour le thé.
Le désordre urbain. Le chaos urbain. Je suis frappé par le désordre de notre ville, Paris. Les poubelles éventrées… Maintenant moins parce qu’il y a forcément moins de monde dans les rues. Les Velibs abandonnés, les trottinettes sur les trottoirs, les vélos qui flottent le long de la Seine… La barbarie urbaine. C’est la chose qui m’impressionne le plus. Ça m’impressionne et ça m’inspire pour dessiner parce que je brutalise le trait du dessin. J’épaissis les traits noirs, je renforce les aplats, je fais éclater les ombres… ça donne un coup de pied dans la fourmilière. Ce désordre secoue le cocotier.
Je me suis interdit ce genre de choses, ce genre de frivolités. Je ne me suis pas autorisé à franchir la barrière et à aller au-delà du féminin. J’ai toujours gardé un aspect un petit peu austère, un peu plus masculin. Pourtant quand je me lâche, les choses peuvent aller très loin en sensualité. Quand je drape, quand je lâche la taille, quand je déboite les épaules… J’ai toujours eu beaucoup de mal avec la caricature du couturier. Ça m’a toujours un peu énervé ce côté un peu affecté. Je ne me suis jamais identifié à cette univers là. J’ai travaillé avec des gens très importants, Gaultier, Castelbajac, Galliano, Kenzo, Agnès b…. Kenzo par exemple, il n’avait pas de muses. Gaultier oui, c’était très BD, Madonna, il y avait toujours des personas. Galliano aussi.
Celle que j’ai eu avec Madame Juliette Cambusarno. C’était très dur. Moi j’avais déjà plus de 30 ans. J’étais ouvrier dans cette boite. Elle était très sévère avec nous mais elle était très intelligente, une femme très cultivée. Je me rappelle un jour, je devais coudre une agrafe et ça ne marchait pas. Elle m’a dit: “Gustavo, vous êtes architecte? Quand vous mettez un poteau sur une poutre, cette poutre tient dans le mur, sinon ça va s’écrouler. Et bien c’est pareil. L’agrafe prend appui sur le tissus, la base du tissus, et la contre-agrafe sur l’autre partie. Et si on tire de chaque côté, ça ne décroche pas. C’est comme l’architecture.“ J’ai travaillé avec elle pendant presqu’un an et demi. Les conditions étaient super dures. On était sur le tabouret. On avait pas le droit de prendre le café ni le matin, ni l’après-midi. On devait fermer sa gueule et tirer l’aiguille. Mais, je voyais cette femme faire les toiles et j’étais émerveillé par la vitesse à laquelle elle faisait tourner le tissus pour obtenir des lignes. Moi, j’étais en train de coudre et en même temps je la regardais faire les toiles. Elle était très dure mais j’ai appris beaucoup. Avec Castelbajac, j’ai appris le sens de la dérision et aussi que tout est possible. Il n’avait peur de rien. Un jour, au restaurant, il a planté son crayon dans son plat de pâtes: “Voilà, je voudrais que la fille sorte d’un plat de pâtes. Tu as compris?“ Il a fait un polaroid et il m’a dit: “C’est le manteau que tu vas faire pour le défilé !“ et ça a été le final. Il avait cette spontanéité, ce génie du moment. C’était à moi de trouver les solutions. Chacun de ceux avec qui j’ai travaillé m’a marqué, à sa manière. Galiano, Kenzo, Gaultier, Agnès b. … Mais j’étais trop autonome. Je savais que j’étais de passage, ça faisait partie de ma stratégie professionnelle. Je ne voulais pas appartenir à une maison. La maison dont je me suis senti le plus proche, c’est Hermès, surtout quand il y avait Pascale Mussard. Mais je ne voulais pas être adopté par une nouvelle famille. La mienne me suffisait.
Je suis un gros dormeur mais quand je me réveille la nuit, je dessine. Ou au petit matin. je dessine mes rêves sans chercher la cohérence. Je remplis des cahiers de dessins à n’en plus finir. Je dessine, je dessine, je dessine… Mais je ne regarde jamais ces dessins. Généralement quand je tombe sur un livre d’histoire ou d’histoire de l’art, et qu’un sujet me plait particulièrement, je cherche à l’approfondir et une fois que je comprends la problématique que l’auteur est en train de traiter, je l’utilise dans mon travail. Si je trouve qu’il y a une résonance entre la problématique de l’auteur et ce que je vis à ce moment là, cette concordance, cette résonance, fait que mon travail va tourner autour de ça.
Là, je suis en train de lire un livre sur la vie d’une esclave africaine en Angola qui subit un procès de l’Inquisition pour bigamie. « Pascoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle », de Charlotte de Castelnau-L’Estoile. Elle cherche par tous les moyens à prouver qu’elle n’était pas bigame parce que le premier mariage qu’elle avait contracté en Angola n’avait pas de valeur. Il n’y avait pas eu de contrat. Un échange d’anneaux mais pas de contrat selon les règles du Concile de Trente. Elle l’explique aux inquisiteurs qui ne veulent bien évidemment rien entendre. Au fur et à mesure que je lis ce livre, il y a une révolte qui nait en moi. Il faut dire que je viens d’une famille esclavagiste. Les ancêtres de mes parents avaient tous des esclaves. L’esclavage est un sujet qui me bouleverse. C’est la plus grande injustice. Se servir de quelqu’un, comme main d’oeuvre, comme propriété. Quand une esclave a un enfant, son enfant, garçon ou fille, appartient au maitre. Donc ce livre suscite énormément de colère. Il y a 3 questions: il y a la question de l’esclavage, le fait que ce soit une femme, et une femme noire. Le mouvement féministe ces dernières années m’interroge aussi sur mon travail. Que faire des symboles d’une féminité qui m’est chère comme les talons hauts, la jupe crayon… mais qui emprisonnent la femme ? Comment libérer tout cela sans tomber dans des anachronismes tout en restant dans le monde contemporain ? C’est une équation compliquée. En cette période de confinement, dire à une femme de porter des talons, des bas en soie… elle te les balance à la figure. Elle veut être en jogging chez elle, elle est tout sauf en représentation.
Quand je crée un modèle féminin sur un mannequin féminin, je n’aime pas quand il renvoie l’image de la femme “vase“. Les vêtements coupés à la taille. Donc je prends ce vêtement, manteau ou chemise, et je le mets sur un corps masculin et j’essaie d’effacer les lignes trop sinueuses. Après je le remets sur le mannequin féminin. Déjà, je déteste les vêtements minuscules, où le corps n’existe pas, où les bras sont très fins… je déteste faire des vêtements pour des mannequins de taille 34. J’aime faire des vêtements pour des vrais gens. C’est pour ça que je n’ai pas un idéal de femme. il y a plusieurs femmes autour de moi, comme il y a plusieurs hommes. Il y a en moi une entité féminine. Je ne vois pas quelle forme elle a mais je sais qu’elle existe. Ces collections sont une manière de faire mon portrait. D’ailleurs, ces vêtements, je peux les porter tous.
Parce que je trouve que c’est une caricature de la femme! La femme n’est pas que ça. Ce qui me plait chez les femmes, c’est une pensée plus virile, plus volontaire, plus affirmée. Ça me gêne une femme qui se sert de ses formes pour un jeu de séduction ou une pseudo-fragilité. Pourtant, j’ai fait des choses très construites que les femmes adoraient, qui marquaient un peu la taille, qui emboitaient les épaules… Je sais faire et je le fais très bien. Mais à un moment donné, tu dois choisir. Tu ne peux pas aller partout. Surtout quand on est modéliste, on a une palette beaucoup plus ouverte par rapport à celles et ceux qui ne maitrisent pas ces techniques et sont par voie de conséquence limités dans leur discours. Il y a un discours chez moi, mais après, il y a la pratique et la pratique, c’est la réalité de l’atelier. Je prends un tissus, je le projette sur un mannequin, je peux tout faire. Ce n’est pas de la fierté mal placée. J’ai cette capacité. Parce que j’ai été modéliste pendant longtemps et pour des gens très différents. J’ai fait des corsets pour certains, des maxi manteaux pour d’autres. J’ai appris à faire des choses très différentes.
Je suis obligé de me plier. Je ne peux pas aller à contre courant. En sachant que les vegans remplacent le cuir par du simili cuir. C’est du plastique. Pour moi, c’est encore pire pour la planète. Quand je vois le désastre qu’est la culture du coton ! On peut parler de la laine aussi, des méthodes de tonte des moutons ! Les vers à soie aussi… L’industrie du textile et de l’habillement pollue énormément. Je trouve qu’il y a une certaine hypocrisie par rapport au cuir. L’autre jour j’écoutais une émission d’un médecin spécialiste en démologie (ensemble des sciences qui concernent le peuple et son environnement). Quand on a découvert les problèmes avec les élevages de visons au Danemark, ils ont du en tuer 18 millions pour limiter la propagation du coronavirus. Il a dit: “ces cultures intensives sont un vrai danger pour l’environnement“. C’est un argument que je peux entendre. Arrêtons ces élevages intensifs de bovins, de caprins… La question du textile n’est pas réglée. Le coton, la soie, la laine, on n’en parle pas assez. On n’a pas inventé de fibre qui puisse les remplacer. Je pense qu’actuellement, on est au milieu d’un vrai tremblement de terre.
D’abord, le recyclage. C’est une piste que je veux développer. J’ai commencé à le faire avec les kimonos et les foulards. Prendre des vêtements existants et les retravailler. Pour que ça marche, il faut conjuguer le passé (les vêtements existant) et le présent (la matière vierge). On peut aussi récupérer des stocks de matières. Mais il ne faut pas non plus se faire trop d’illusion, on va devoir relancer une économie. Si on n'achète plus de matières, on casse une industrie. Il y a un équilibre à trouver. Je n’ai pas la solution mais cela fait partie de mes recherches. Il y a aussi la dimension humaine. La machine à coudre par exemple, c’est la pire des choses qu’on ait pu inventer. Ça prend un temps fou ! Tu es là assis à pédaler… Pourtant j’adore ! Pour moi, c’est presque méditatif, mais quelqu’un qui fait ça toute la journée, qui ne fait que ça, c’est abrutissant. La machine à coudre a été inventée si ma mémoire est bonne en 1830 ou 32 et, à ce jour, on ne l’a pas faite évoluer. On a juste inventé un crochet pour la canette. C’est un outil tel qu’il a été inventé par Singer à l’origine, on l’utilise de la même façon. Ok, on a mis un moteur mais fondamentalement, elle n’a pas évolué tant que ça. Pour faire un vêtement, tu coupes et tu assembles. Plus il y a de coutures, plus il y a d’assemblage. J’ai réussi, en jouxtant les patrons, à ce qu’il y ait le moins de coutures possible. Mais malgré tout, ça prend un temps fou et ça a un coût énorme. Là, je suis en train de faire des pantalons. Faire des pantalons, c’est presqu’aussi long que de faire des vestes. Le prix du pantalon ne peut pas dépasser un tiers du prix de la veste parce qu’il ne porte pas sa valeur. Mais pour faire un beau pantalon, bien fini, que tu as envie de porter, avec de belles finitions à l’envers, ça prend du temps et ça ne se voit pas. On est actuellement entre deux mondes : le monde à venir n’existe pas encore et le monde révolu agonise. Quand j’étais en Espagne pendant mes études, mon maitre de thèse m’a fait travailler sur Vladimir Tatline, un plasticien de la révolution Bolchevique pour qui l’homme révolutionnaire après 1917 ne pouvait pas s’habiller comme à l’époque du tsar. Il a donc fait une recherche sur le vêtement. Il a pris une planche de coupe de veste de tailleur (je ne sais plus combien il y avait de morceaux) et il a assemblé tous les morceaux comme un kimono. Il y a aussi l’italien Thayaht, qui a fait la combinaison (TuTa) dans le mouvement futuriste. Tous ces hommes, dans cette période révolutionnaire, au début des années 20, avant que Staline arrive au pouvoir, ont participé à la période la plus productive de la révolution soviétique. J’ai l’impression qu’on traverse un moment similaire avec la pandémie, la crise économique, sociale, éthique. On a l’opportunité de mettre en place quelque chose de différent.
Ce que j’ai retenu des vêtements d’Issey Miyake c’est que ce n’était pas le vêtement qui l’intéressait, ni le corps, mais l’espace entre le corps et le vêtement. J’aime qu’il y ait de l’espace entre le corps de la personne et le vêtement. C’est très important cette ampleur, cette manière dont le corps bouge d’un côté et le vêtement de l’autre, l’idée d’un vêtement ample qui ne va pas contraindre le corps. J’aime aussi les vêtements qui sont issus du langage militaire. Les manteaux qui sont de vraies carapaces, des protections, comme des tanks. Tu les portes pour te donner une vraie protection physique, une protection morale, sociale… Ils te donnent une attitude, une posture. Ce sont des abris, un habitat. Ça renvoie à ce que je disais au départ: associer architecture et vêtement. La tente est quelque chose qui m’intéresse également. Tu la roules, tu pars avec, tu t’installes ailleurs. C’est le vêtement du nomade. J’aime cette idée de vêtement et de personne en mouvement. Ce que je recherche lorsque je mets un vêtement sur le mannequin, c’est de retrouver l’idée de mouvement. Je n’aime pas les choses statiques, figées. Dans la construction d’un manteau, je crée le mouvement avec les lignes de couture qui parfois tournent en courbe ou en spirale. Ça crée une dynamique visuelle et on a l’impression que la manche va se plier naturellement, accompagner le bras avec aisance. L’idée de mouvement, de confort, c’est très important. Je déteste être gêné aux entournures.
Le manteau. Parce que c’est la pièce qui recouvre. C’est le toit. C’est la pièce qui vient par-dessus. Selon que tu la gardes ouverte ou fermée, tu dis des choses différentes. C’est une pièce que tu mets par-dessus un simple T-shirt ou avec une veste ou avec un pull… C’est la pièce qui m’impressionne le plus.
Visuel. Les manteaux du soir en haute couture, par exemple, c’est très impressionnant. Ils ne servent qu’entre le moment où tu quittes la voiture et celui où tu arrives au vestiaire. Ils ont une durée d’utilisation très éphémère ! 15 mn au plus, selon la file d’attente à l’entrée de la soirée et peut être 30 à la sortie. Pourtant, c’est une pièce très forte. J’ai beaucoup étudié les dessins de mode des années 30-40-50, surtout ceux de l’illustrateur Eric dont j’adore le travail. Les manteaux du soir y ont un rôle capital. Maintenant on ne fait plus ça du tout. Le chic du chic, c’est d’enfiler un cardigan en laine, un manteau d’homme, un trench, sur une robe du soir. Ces codes sont révolus. Mais on n’a toujours pas réglé le problème de la chaussure à talon ! La grosse différence entre les hommes et les femmes, c’est que les femmes vivent la féminité, les hommes se contentent de la regarder. C’est très différent d’être acteur ou observateur. L’acteur sais dans son corps la contrainte que cela représente : marcher à petits pas, faire des gestes mesurés, ne jamais être assise avec certaines jupes, être toujours en posture de représentation… Un homme admire ça. La beauté féminine qui en ressort est magnifique mais on oublie la contrainte. Les femmes ne se rendent souvent même plus compte de la contrainte. Certaines ne sentent même pas les conséquences désastreuses d’un talon de 11 cm sur leur colonne vertébrale. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Au Brésil on dit que les piments dans le derrière des autres ne brulent pas. C’est très vulgaire mais très vrai. Jusqu’à il n’y a pas très longtemps, la mode était commandée par les hommes. Les femmes à la tête des maisons de mode, c’est très récent et beaucoup de femmes n’ont pas fait la révolution du plat. Sonia Rykiel avait des chaussures à talon compensé, donc hautes quand même, un peu japonaises. L’inversion des rôles est très récente dans l’histoire du costume. Je comprends qu’il y ait une résistance énorme par rapport à ça. Ça renvoie à une idée de la femme soumise aux hommes. Et il faut en tenir compte maintenant.
Quand on fait un projet d’architecture, on reconnait la patte de l’architecte mais c’est l’usager, l’habitant, qui va donner à cette maison une personnalité. Je me positionne encore comme un architecte. Ça synthétise tout ce que je dis. C’est pour ça que si je fais de la broderie, je la ferai comme un ornement, comme en architecture. Ce ne sera pas de la décoration. La décoration, c’est la personne qui occupe la maison qui la choisit : les tableaux, les meubles, les miroirs…. L’architecte crée un cadre d’ombre et de lumière, mais son rôle est celui d’un relai. C’est un truc que j’ai bien appris quand j’étais nageur. Dans mon métier aussi, c’est une histoire de relai. Une fois que les vêtements sont faits, la boutique l’interprète en créant des silhouettes pour sa vitrine, ou encore la rédactrice de mode qui va mettre en scène les photos pour son magazine, ou même l’influenceuse qui va les porter sur son compte Instagram. Ce n’est plus moi, ça ne m’appartient plus. Je crois avoir vraiment cette humilité. Je n’ai pas la prétention d’être présent jusqu’au bout de la chaine. Les grandes marques vendent des silhouettes de la tête aux pieds, y compris la palette de maquillage. Je n’ai jamais cru à ça. Le truc qui m’a plu quand j’ai commencé à faire ce métier, c’est quand les boutiques multi marques me disaient avec qui ils me présentaient. “On te met à côté de Rick Owens, de Carol Christian Poell, d’Ann Demeleumeester… ça marche très bien parce qu’on peut mélanger“. J’ai toujours aimé cette ouverture, cette proximité. J’ai presqu’envie de ne pas travailler des thèmes complets, de toujours laisser une brèche pour q’une marque complémentaire vienne se greffer. Et pour que la personne qui vient nous acheter se sente libre de mélanger avec d’autres pièces. J’espère que ce sera ça le monde d’après, une ouverture, de la diversité.
![]()
C'était quoi grandir au Brésil ?
Je suis né à Belo Horizonte, au Brésil, dans une famille de 9 enfants. Mon père était chirurgien. Depuis tout petit, j'adorais passer du temps avec lui, il me montrait ses planches d'anatomie. Il m'expliquait comment fonctionne le corps humain et il me disait : “si tu veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, sache comment fonctionne ton corps“. Donc depuis tout petit, j'étais habitué à voir ces dessins de l’anatomie du corps humain, de la musculature… Ensuite , il y a eu la natation. J'ai commencé à nager à l'âge de 9 ans. Je suis devenu un très bon nageur, j’ai fait de la compétition. J'étais un enfant extrêmement anxieux, mon père pensait que la natation me ferait du bien. Le rapport à l'eau est resté un truc très fort. Et puis, il y a eu le cheval. Mon oncle avait une magnifique propriété à l'intérieur du pays. On y allait pendant les vacances. On faisait du cheval tous les jours. J’ai été très tôt familiarisé avec l'animal, avec son environnement, le cuir, les selles… La construction de la selle, j'y reviens toujours.
Je me souviens que nos vêtements étaient fabriqués à la maison. Il y avait un atelier de couture où une couturière venait régulièrement. Une bonne couturière venait pour ma mère et mes sœurs. Une autre dame venait pour nous, les garçons, mais j'étais rarement content du résultat. J'étais toujours frustré par la réalisation. Le vêtement, pour moi, c’ était une fascination, et aussi une source d'angoisse. Nous étions d’un milieu assez favorisé et, à l’adolescence, alors qu’on commençait à sortir, les jeunes portaient des vêtements de marque que je ne pouvais pas avoir et j'ai développé un certain rejet par rapport aux vêtements. Moi, j’avais mon uniforme: un pantalon kaki, un t-shirt bleu et mon maillot de bain. C’était tout. Plus tard, quand je suis rentré à l'école d’architecture, je gagnais très bien ma vie, j’avais pris un job à mi-temps dans une banque d'affaires. La première année, j'ai littéralement grillé mon salaire en vêtements idiots. Des vêtements de marque brésilienne. J’ai fini par me rendre compte que c'était une grosse connerie: non seulement ces vêtements étaient mal coupés mais ils étaient très chers pour ce que c'était. Je suis donc revenu aux bonnes vieilles méthodes. J'ai acheté une pièce de lin et une de laine froide, je suis allé voir un tailleur pour mes pantalons et une couturière pour mes chemises. Quand je suis allé en classe avec, mes copains et mes copines voulaient absolument m'acheter ce que je portais. J’ai trouvé ça un peu bizarre au début mais j'ai accepté de vendre une de mes chemises à un ami. Ça a commencé comme ça. Jusqu'au jour où une copine m’a encouragé à devenir styliste de mode. Pour moi, ce n’était pas un métier. Tout le monde faisait ça pour s’habiller. Elle m’a fait découvrir la collection dalmatien de Jean-Paul Gaultier et j'ai eu un déclic. J'ai compris que les vêtements, la mode, pouvait être conçus comme un projet d’architecture et j'ai commencé à dessiner des vêtements. Je dessinais tout le temps des figurines. Quand nous avons du dessiner des perspectives, pour nos projets d’architecture, il fallait y intégrer des personnages en mouvement. J’en faisais des figurines de mode et je suis vite devenu l'illustrateur de la classe. C’est en 3ème année que je me suis rendu compte que c’était vraiment ça que je voulais faire. Mais je devais finir ce que j'avais commencé et passer mon diplôme d'architecte. Parallèlement, j’ai monté un petit business de vêtements. J'achetais du tissu, je coupais les vêtements, j'allais chez la couturière, et je les vendais mais je n’étais pas très à l’aise, je ne connaissais pas les techniques de coupe. Pour moi, c’était un mystère. Je ne savais pas comment faire un patron. J’ai passé mon diplôme en décembre 1986. Je suis parti à Barcelone un mois après. Je ne pensais pas y rester très longtemps mais je voulais faire quelque chose de mon temps là-bas et je me suis inscrit dans un cours de “coupe tailleur“ où je n’ai strictement rien appris. C’était vraiment des recettes de cuisine que je ne comprenais absolument pas. Au bout de 4 mois de bourrage de crâne, le jour où j’ai voulu assembler un vêtement, je n’ai pas su mettre la manche sur le corps et j’ai repris les planches d’anatomie. En observant le corps, le vêtement et le patron tout a pris sens. L’année suivante, j’ai commencé un doctorat d’architecture. Depuis toujours, j’étais fasciné par le Japon et l’architecture japonaise. Je me disais que peut être il y avait un rapport entre le vêtement et l’architecture. Mon maitre de thèse m’a invité à aller voir une boutique dans le haut très chic de Barcelone où j’ai pu voir et toucher des vêtements d’Issey Miyake et d’Azzedine Alaia. J’ai adoré et j’ai commencé à faire un travail qui associait le vêtement et l’architecture. D’Alaia, j’ai retenu le corps, la musculature, le vêtement comme une armure, les coutures en spirale qui suivent la ligne de jointure des muscles. Les muscles ne se rencontrent jamais de façon orthogonale, c’est toujours en diagonale. Issey Miyake, c’était le kimono, l’influence de Madeleine Vionnet. Je me suis dit, mon histoire elle est là : je vais travailler sur l’armure et le kimono. Le kimono est devenu ma marotte. Je prenais des kimonos anciens que je drapais, que je torturais, que je surpiquais.
Au moment de finir mes études à Barcelone, mon maitre de thèse m’a dit: “je ne vous demande pas de faire une thèse académique, scolaire, je vous demande une pratique de coupe. Pour cela, il va falloir travailler 10 ans comme modéliste pour comprendre ce qu’est la construction“. J’ai accepté le défi et quelques mois après, j’arrivais à Paris pour les vacances d’abord et je suis resté. Comme on dit au Brésil, il y a un cheval harnaché qui est passé et je suis monté sur la croupe ! J’ai vu que c’était à Paris que je pourrais vraiment exercer ce métier. Seulement, avant de me lancer dans la création, ne connaissant personne, n’ayant aucune connexion, il valait mieux que j’apprenne d’abord à être un très bon technicien, que je maitrise bien toutes les techniques de couture, pour envisager plus tard la conception. En 12 ans, j’ai travaillé pour plusieurs maisons de couture, comme modéliste, comme ouvrier qualifié, comme chef d’atelier… Et c’est seulement à 40 ans que j’ai décidé qu’il était temps que je raconte ma propre histoire. J’ai monté ma société fin 2002. Je pensais que le Brésil ne m’avait jamais vraiment marqué. Avec le temps, pourtant, je me rends compte que la palette de couleurs que j’emploie est très minérale. Je viens d’une région de mines, le Minas Gerais. La palette des couleurs y est plutôt grise, voire noire. Je suis finalement influencé par ces couleurs sourdes loin du folklore très coloré des tropiques. Là-bas, quand il fait très chaud, l’été, le soleil est tellement fort qu’il grise les couleurs. La nature et toute la gamme des verts deviennent grises, seulement ponctuée de couleurs vives. Jaune, violet… Finalement, je peux dire aujourd’hui que cette culture un peu hybride, 1/3 européenne, 1/3 indigène, 1/3 africaine, est la base de ma personnalité.
Tu ne m’as pas beaucoup parlé de ton enfance ?
J’étais un petit garçon hyper angoissé. J’avais peur de tout. J’avais peur de la vie. J’avais une angoisse qui me rongeait de l’intérieur. Le vêtement aussi était une source d’angoisse parce que c’était un terrain interdit à la maison. On habitait une grande maison avec un jardin qui donnait sur la rue et derrière, il y avait une arrière-cour et il y avait les communs où les femmes de service habitaient et une des chambres était l’atelier de couture dont je parlais tout à l’heure. Nous n’avions pratiquement pas le droit d’y aller. C’était le domaine des personnes qui travaillaient à la maison et c’était aussi un univers très féminin. J’étais à la fois effrayé et fasciné par ce monde. J’étais un garçon hyper solitaire. Hyper maladroit. Quand on devait jouer au foot, j’avais un mal fou avec la coordination des mouvements de mes pieds. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas attraper le ballon avec les mains. Comme j’étais très mauvais, on m’a mis comme ramasseur de ballon. Ça ne m’allait pas du tout. Heureusement, j’ai commencé à nager. Cela me convenait bien mieux, un sport individuel !
J’ai été un excellent élève et comme la plupart des bons élèves, j’étais très angoissé par l’école. J’avais de très bons résultats et j’ai été totalement autonome dès l’âge de 10 ans. Je n’avais besoin de personne pour m’aider. Mais il y avait ce sentiment d’abandon et de solitude profonde malgré ma nombreuse famille (16 personnes vivaient sous le même toit). Il y avait toujours beaucoup de monde à la maison mais j’étais hyper isolé.
Tu étais le petit dernier ?
Non ma mère a eu 10 grossesses, je suis la 7ème grossesse mais le 6ème enfant (elle en a perdu un). Après moi, il y en a eu 3.
Beaucoup de créateurs ont été influencés par une femme proche (la mère, une grand-mère, parfois même par l’absence de la mère…) qu’en est-il pour toi ?
Dans notre milieu social, on croisait des gens très très riches. Mon père avait une situation très confortable, très privilégiée, mais il avait quand même 9 enfants à charge, inscrits dans des écoles privées. Il y avait beaucoup de réceptions, de mariages… Ma mère était très débrouillarde. Elle s’était constitué des “uniformes“. Quand on allait dans ces soirées, j’observais que toutes les autres femmes portaient des robes brodées, des drapés… Ma mère ne s’habillait pas comme ces femmes-là. Elle considérait que pour avoir une robe drapée, il fallait avoir un très bon couturier, qui sache le faire, sinon on avait l’impression de porter un rideau de douche, que la broderie pouvait être vite vulgaire, vous faisant ressembler à un sapin de Noel. Elle préférait porter des choses plus strictes. Elle avait quelques bijoux (à chaque fois qu’elle avait un enfant, mon père lui offrait un bijou, donc elle en avait 10). Et avec ça, elle faisait son mix. Elle inventait. Elle prenait un chapeau, elle enlevait le bord, elle retournait la calotte. Elle décousait une robe… Elle se débrouillait. C’était une femme très douée et elle avait une bonne couturière. Je trouvais qu’elle avait raison d’aller vers cette sobriété, avec cette recherche de ligne, de silhouette, plus que d’effets. Mon père, qui était un esthète, ne l’a jamais contrariée. C’était un couple qui fonctionnait bien. Ils étaient très amoureux, ils avaient une admiration mutuelle. Mon père comprenait parfaitement comment un vêtement était cousu. Il allait chez son tailleur faire faire ses costumes et il savait quand un vêtement était mal coupé, quand il tombait mal. Comme je l’ai dit plus tôt, la couture était une activité très présente à la maison. J’avais 4 soeurs. Il y avait 4, 5 ou 6 mariages par an et, chaque fois, il fallait habiller toute cette troupe. Je pensais que nous étions les cousins pauvres parce que nous n’avions pas les moyens de porter ce que les autres portaient mais quand j’ai commencé ce métier, je me suis rendu compte de l’importance de l’éducation que j’ai reçu: “less is more“. Très peu d’effet et les couleurs qu’il faut maitriser avec beaucoup de sagesse. En dépit des conflits et des différents que j’ai pu avoir avec ma mère, elle m’a beaucoup appris. À l’age de 10 ans, à la fin de l’école primaire, c’était la mode du tie & die, elle avait fait quelque t-shirts pour mes soeurs et pour ses amies. On avait des cousines fortunées qui avaient trouvé ça intéressant et lui avaient passé commande. Elle en a fait un petit business. Moi, j’étais tout le temps collé au fourneau pour mélanger les couleurs. Elle m’avait appris les formules qu’elle connaissait et m’avait envoyé chez un allemand qui avait une droguerie en centre ville où il vendait des pigments de très bonne qualité. Il m’a montré comment faire la gamme de couleurs, m’a appris les différentes combinaisons, d’autres formules, les dosages, les temps de prise… J’ai fait ça pendant 3 ou 4 mois. J’allais 2 fois par semaine acheter des pigments et des tissus. Je partais en bus et je revenais à pied pour économiser l’argent du bus. Avec l’argent que j’ai gagné, j’ai pu partir en vacances 3 semaines, je me suis acheté une montre, une paire de raquettes de tennis de plage et un ballon en cuir. C’est la première fois que j’ai vraiment travaillé. À 10 ans, j’avais compris ce qu’était le travail et qu’on pouvait gagner sa vie avec ce qu’on aimait faire. Ça a été une expérience très forte de mon enfance. J’étais très complexé par rapport à mes frères plus âgés. Ils avaient plus de panache. J’ai toujours vécu dans leur ombre. Il m’a fallu beaucoup de temps pour me libérer de cette enfance. Les études m’ont sauvé. Et le sport. Je pouvais nager 10 km par jour.
Tu avais commencé par des études d’ingénieur, puis d’architecte…
Dans cette famille très traditionnelle, les garçons pouvaient faire médecine pour être de préférence chirurgien, faire du droit pour être dans la haute magistrature, ou ingénieur des ponts et chaussées. À 17 ans, je passais mon bac et les concours des grandes écoles, mais je ne me voyais dans aucune case. J’ai opté pour ingénieur des mines. Je pensais à tort que cela pouvait être un peu plus drôle que les Ponts & Chaussées. J’ai intégré l ‘école et ça a été un vrai cauchemar. J’ai craqué. Une fois de plus, mon père est intervenu. Il m’a dit: “Quand je vois ta calligraphie, je suis certain que tu peux dessiner“. Il m’a apporté quelques livres de dessin et je me suis mis à dessiner. J’adorais ça. Il m’a orienté vers l’architecture, ça lui semblait un bon compromis. Mais bon, je n’étais plus dans le peloton de tête. J’ai préparé le concours d’architecture que j’ai eu sans trop de problème et ça m’a libéré. J’y ai rencontré des personnes beaucoup plus libres, plus drôles, qui avaient plus ou moins rompu avec leurs familles bourgeoises et traditionnelles. Parallèlement, j’ai passé un concours pour un job dans une banque d’état. Je gagnais très bien ma vie et j’habitais encore chez mes parents. J’avais presque 16 salaires par an car nous dépendions de la bourse qui allait très bien à l’époque et on pouvait faire des placements. C’était les années 80. Quand je pense au Brésil, même encore aujourd’hui, j’ai des poussées d’angoisse très forte. Il y avait beaucoup de violence, une brutalité, dans ce pays qui ne me donnait pas envie d’y vivre.
Pourquoi l’Europe ?
L’Europe c’était le grand fantasme des anciennes colonies. Dans l’inconscient collectif, il y avait une espèce de nostalgie d’un monde révolu. Le milieu dans lequel je vivais était très europhile. Les gens y lisaient le français couramment ou étaient très attirés par la France. Mes tantes, mes grand-tantes, voyageaient tout le temps. Je me rappelle les avoir accompagnées au bateau. Elles partaient pendant 2 mois, elles traversaient l’Atlantique, elles restaient 2 mois sur place et quand elles revenaient, il y avait une odeur particulière quand on ouvrait les malles et les cadeaux. Depuis tout petit, j’avais envie d’aller là d’où elles revenaient. Les États-Unis ne m’ont jamais attiré alors que ma génération voulait vivre le rêve américain. Moi, j’écoutais ce que mes tantes me racontaient des villes comme Paris, Londres, Rome… Il y a toujours eu ce fantasme européen. Mes parents étaient extrêmement orientés vers la culture européenne.
Toutes les bifurcations de ton parcours donnent-elles une couleur particulière à ton travail?
Mon travail, c’est une recherche d’une géométrie euclidienne (le carré, le rectangle, le triangle, le cercle) dans les courbes que l’on retrouve dans la nature. Le meilleur exemple, c’est quand tu regardes un jardin japonais à vol d’oiseau. Tu vois les pans des toitures, des pans rectangulaires, des rectangles coupés par des triangles que l’on appelle les pans des eaux. Et autour, les jardins avec des formes très organiques. C’est un mélange de la ligne et de la courbe. Le cercle pour moi reste une ligne et la spirale, une ligne en 3 dimensions. Pour ce qui est du persona, après 17 ans d’expérience en création, je me pose la question: est-ce qu’il y a quelqu’un, un persona, qui pourrait illustrer ce que je fais? Je commence à voir des bribes d’intuition. Ce n’est pas encore clair. L’idée de l’homme est très précise pour moi: c’est un homme hybride, libre, qui a traversé les âges. La question de la femme, je ne sais pas trop parce que je suis encore très perturbé par cette image de ma mère qui m’a beaucoup impressionné mais qui m’a aussi fait beaucoup de tort pendant mon enfance et mon adolescence. C’est un modèle féminin qui m’a fasciné mais qui m’a aussi terrorisé. Le modèle masculin est plus clair. Mon père était un homme très doux, très intelligent, très perspicace. Il ne me mettait pas du tout en danger. Ce que je fais par rapport à la mode est très psychanalytique. C’est vraiment la théorie freudienne: le père et la mère. Et je suis en plein milieu et je ne sais pas de quel côté pencher. Peut être que, maintenant, je sais qu’il ne faut pencher d’aucun côté. Il faut rester au centre, inébranlable, quoi qu’il arrive. Et laisser la tornade tourner autour. C’est peut être ça la conclusion de toutes les analyses que j’ai pu faire depuis l’âge de 19 ans. La conclusion c’est ça, il ne faut pas se laisser impressionné par la périphérie, il faut rester au centre. Je crois aussi que l’identité n’est pas unique, elle peut bouger tout le temps. Il n’y a pas un homme et il n’y a pas une femme. Nous-mêmes, en tant qu’être humain, nous sommes plusieurs personnes tout au long de notre existence. Je ne suis plus aujourd’hui la même personne que j’étais à 30 ans. Je crois que quand on fait ce métier de la mode, c’est très important de laisser le persona vieillir. On ne peut pas figer comme certains couturiers le font, parce qu’ils ont, je pense, une relation œdipienne très forte avec leur mère. Ils figent leur mère dans l’histoire de leur vie et passent leur temps à rechercher cette image. Moi, c’est tout le contraire. La mère pour moi, c’est l’épouvantail qui m’a fait aller vers des choses plus évoluées.
Y a-t-il d’autres personnes qui t’ont influencé? Architectes, designers, artistes…?
Il y a quelqu’un que j’aime beaucoup, c’est Jean Prouvé. La manière dont il fait les meubles et son travail à l’Observatoire de Paris. De temps en temps je regarde les solutions de détails de ses meubles, comment le bois est coupé… Charlotte Perriand est aussi très présente dans mes créations. Mais peut être que la plus forte influence c’est Giorgio Morandi. Rien que d’y penser, j’ai les larmes aux yeux. Il a su magnifiquement exprimer les heures de la journée, la lumière. Il prend toujours les mêmes éléments, le même beurrier, les mêmes carafes, les mêmes tasses… Ce sont toujours les mêmes objets vus à des moments, des saisons différentes, avec des lumières différentes. C’est d’une subtilité, d’une beauté qui est très difficile à exprimer à travers des collections de vêtements où on est obligé de changer tout le temps, d’apporter des nouvelles formes. J'aime chez Morandi cette constance du sujet et cette inconstance de la lumière. Ces deux paramètres rendent son œuvre unique. Il est très présent chez moi, mais pas de manière formelle, c’est l’inspiration profonde. Sinon, l’Espagne et surtout la culture du flamenco. La musique, les costumes, le monde des gitans, Garcia Lorca, Manuel de Falla. Cette musique me met en transe. Quand je vois les volants s’envoler, ça me rend dingue. Quand ils tapent, les “tablado“, tout remonte, j’entre en transe. La gamme de couleur noire que je retrouve chez Velasquez, Goya, Zurbaran… Tous ces peintres du 17ème ou du 18ème siècle espagnol m’ont beaucoup appris et ce grâce a une personne extraordinaire avec qui j’ai travaillé qui était chez Balenciaga avant la fermeture : Juliette Cambusarno. Elle était première d’atelier à l’atelier tailleur. Elle m’a donné plein de pistes pour décrypter le travail de Balenciaga et elle m’avait dit : “la clé majeure est dans la peinture. Il faut voir les tableaux de Goya, de Velasquez, du Greco, pour comprendre Balenciaga“. Et en effet , quand j’ai vu la gamme de noirs, teintés de bleu, de vert, de rouge, j’ai trouvé ça fascinant, comment il a su si bien exprimer la culture espagnole à travers sa mode qui était très austère. Tout sauf drôle. Mais très osée quand il mettait du rose à côté du vert et du noir. C’est quelque chose qu’à l’époque on ne faisait pas en France. Mes influences sont très diverses mais à un moment donné, je fais mon cocktail, le trait d’union restant le kimono japonais. Je l’utilisais entre autre pour dédramatiser la haute couture avec son côté “casual“ : sortie de bain, vêtement pour dormir, vêtement d’apparat, vêtement de cérémonie… ça reste toujours le même patron mais l’image change selon la circonstance. C’est l’histoire du signe et de la sémiotique. Tu as le signe, tu as l’objet et ce qu’il veut dire, ce qu’il représente. C’est grâce au kimono japonais que j’arrive à conjuguer à ma manière toutes ces influences tous azimuts.
Il y a quand même une similitude. Tu parles du kimono qui reste unique bien qu’adapté à toutes les circonstances et Morandi qui fait toujours la même chose sous des lumières différentes ?
Oui c’est vrai. Dans la construction des tableaux de Morandi, il y a une verticalité. C’est encore plus flagrant dans ses dessins. Comment il hachure ses ombres pour découper l’ombre et la lumière, on a de vraies verticales blanches apposées aux verticales hachurées. Et le kimono, c’est une base carrée qui renvoie aussi à la verticalité. Les lignes sont verticales, le col est vertical, les pans sont verticaux, et pourtant quand on mesure une pièce de tissus pour un kimono, on retrouve un module carré en divisant la longueur par la largeur. Ce sont aussi les proportions d’un tatami: 2 carrés, 90x180. Le plan d’une maison japonaise part de tatamis assemblés avec parfois un carré au milieu de la pièce, c’est l’élu du foyer. C’est là où l’on fait chauffer l’eau pour le thé.
Qu’est ce qui t’inspire aujourd’hui ?
Le désordre urbain. Le chaos urbain. Je suis frappé par le désordre de notre ville, Paris. Les poubelles éventrées… Maintenant moins parce qu’il y a forcément moins de monde dans les rues. Les Velibs abandonnés, les trottinettes sur les trottoirs, les vélos qui flottent le long de la Seine… La barbarie urbaine. C’est la chose qui m’impressionne le plus. Ça m’impressionne et ça m’inspire pour dessiner parce que je brutalise le trait du dessin. J’épaissis les traits noirs, je renforce les aplats, je fais éclater les ombres… ça donne un coup de pied dans la fourmilière. Ce désordre secoue le cocotier.
As-tu des muses ?
Je me suis interdit ce genre de choses, ce genre de frivolités. Je ne me suis pas autorisé à franchir la barrière et à aller au-delà du féminin. J’ai toujours gardé un aspect un petit peu austère, un peu plus masculin. Pourtant quand je me lâche, les choses peuvent aller très loin en sensualité. Quand je drape, quand je lâche la taille, quand je déboite les épaules… J’ai toujours eu beaucoup de mal avec la caricature du couturier. Ça m’a toujours un peu énervé ce côté un peu affecté. Je ne me suis jamais identifié à cette univers là. J’ai travaillé avec des gens très importants, Gaultier, Castelbajac, Galliano, Kenzo, Agnès b…. Kenzo par exemple, il n’avait pas de muses. Gaultier oui, c’était très BD, Madonna, il y avait toujours des personas. Galliano aussi.
De toutes ces expériences là, laquelle t’a le plus marqué ?
Celle que j’ai eu avec Madame Juliette Cambusarno. C’était très dur. Moi j’avais déjà plus de 30 ans. J’étais ouvrier dans cette boite. Elle était très sévère avec nous mais elle était très intelligente, une femme très cultivée. Je me rappelle un jour, je devais coudre une agrafe et ça ne marchait pas. Elle m’a dit: “Gustavo, vous êtes architecte? Quand vous mettez un poteau sur une poutre, cette poutre tient dans le mur, sinon ça va s’écrouler. Et bien c’est pareil. L’agrafe prend appui sur le tissus, la base du tissus, et la contre-agrafe sur l’autre partie. Et si on tire de chaque côté, ça ne décroche pas. C’est comme l’architecture.“ J’ai travaillé avec elle pendant presqu’un an et demi. Les conditions étaient super dures. On était sur le tabouret. On avait pas le droit de prendre le café ni le matin, ni l’après-midi. On devait fermer sa gueule et tirer l’aiguille. Mais, je voyais cette femme faire les toiles et j’étais émerveillé par la vitesse à laquelle elle faisait tourner le tissus pour obtenir des lignes. Moi, j’étais en train de coudre et en même temps je la regardais faire les toiles. Elle était très dure mais j’ai appris beaucoup. Avec Castelbajac, j’ai appris le sens de la dérision et aussi que tout est possible. Il n’avait peur de rien. Un jour, au restaurant, il a planté son crayon dans son plat de pâtes: “Voilà, je voudrais que la fille sorte d’un plat de pâtes. Tu as compris?“ Il a fait un polaroid et il m’a dit: “C’est le manteau que tu vas faire pour le défilé !“ et ça a été le final. Il avait cette spontanéité, ce génie du moment. C’était à moi de trouver les solutions. Chacun de ceux avec qui j’ai travaillé m’a marqué, à sa manière. Galiano, Kenzo, Gaultier, Agnès b. … Mais j’étais trop autonome. Je savais que j’étais de passage, ça faisait partie de ma stratégie professionnelle. Je ne voulais pas appartenir à une maison. La maison dont je me suis senti le plus proche, c’est Hermès, surtout quand il y avait Pascale Mussard. Mais je ne voulais pas être adopté par une nouvelle famille. La mienne me suffisait.
Quel est ton processus créatif ?
Je suis un gros dormeur mais quand je me réveille la nuit, je dessine. Ou au petit matin. je dessine mes rêves sans chercher la cohérence. Je remplis des cahiers de dessins à n’en plus finir. Je dessine, je dessine, je dessine… Mais je ne regarde jamais ces dessins. Généralement quand je tombe sur un livre d’histoire ou d’histoire de l’art, et qu’un sujet me plait particulièrement, je cherche à l’approfondir et une fois que je comprends la problématique que l’auteur est en train de traiter, je l’utilise dans mon travail. Si je trouve qu’il y a une résonance entre la problématique de l’auteur et ce que je vis à ce moment là, cette concordance, cette résonance, fait que mon travail va tourner autour de ça.
Tu as un exemple ?
Là, je suis en train de lire un livre sur la vie d’une esclave africaine en Angola qui subit un procès de l’Inquisition pour bigamie. « Pascoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle », de Charlotte de Castelnau-L’Estoile. Elle cherche par tous les moyens à prouver qu’elle n’était pas bigame parce que le premier mariage qu’elle avait contracté en Angola n’avait pas de valeur. Il n’y avait pas eu de contrat. Un échange d’anneaux mais pas de contrat selon les règles du Concile de Trente. Elle l’explique aux inquisiteurs qui ne veulent bien évidemment rien entendre. Au fur et à mesure que je lis ce livre, il y a une révolte qui nait en moi. Il faut dire que je viens d’une famille esclavagiste. Les ancêtres de mes parents avaient tous des esclaves. L’esclavage est un sujet qui me bouleverse. C’est la plus grande injustice. Se servir de quelqu’un, comme main d’oeuvre, comme propriété. Quand une esclave a un enfant, son enfant, garçon ou fille, appartient au maitre. Donc ce livre suscite énormément de colère. Il y a 3 questions: il y a la question de l’esclavage, le fait que ce soit une femme, et une femme noire. Le mouvement féministe ces dernières années m’interroge aussi sur mon travail. Que faire des symboles d’une féminité qui m’est chère comme les talons hauts, la jupe crayon… mais qui emprisonnent la femme ? Comment libérer tout cela sans tomber dans des anachronismes tout en restant dans le monde contemporain ? C’est une équation compliquée. En cette période de confinement, dire à une femme de porter des talons, des bas en soie… elle te les balance à la figure. Elle veut être en jogging chez elle, elle est tout sauf en représentation.
Tu développes des modèles unisexe depuis toujours, pourquoi ?
Quand je crée un modèle féminin sur un mannequin féminin, je n’aime pas quand il renvoie l’image de la femme “vase“. Les vêtements coupés à la taille. Donc je prends ce vêtement, manteau ou chemise, et je le mets sur un corps masculin et j’essaie d’effacer les lignes trop sinueuses. Après je le remets sur le mannequin féminin. Déjà, je déteste les vêtements minuscules, où le corps n’existe pas, où les bras sont très fins… je déteste faire des vêtements pour des mannequins de taille 34. J’aime faire des vêtements pour des vrais gens. C’est pour ça que je n’ai pas un idéal de femme. il y a plusieurs femmes autour de moi, comme il y a plusieurs hommes. Il y a en moi une entité féminine. Je ne vois pas quelle forme elle a mais je sais qu’elle existe. Ces collections sont une manière de faire mon portrait. D’ailleurs, ces vêtements, je peux les porter tous.
Pourquoi vouloir effacer la silhouette féminine ?
Parce que je trouve que c’est une caricature de la femme! La femme n’est pas que ça. Ce qui me plait chez les femmes, c’est une pensée plus virile, plus volontaire, plus affirmée. Ça me gêne une femme qui se sert de ses formes pour un jeu de séduction ou une pseudo-fragilité. Pourtant, j’ai fait des choses très construites que les femmes adoraient, qui marquaient un peu la taille, qui emboitaient les épaules… Je sais faire et je le fais très bien. Mais à un moment donné, tu dois choisir. Tu ne peux pas aller partout. Surtout quand on est modéliste, on a une palette beaucoup plus ouverte par rapport à celles et ceux qui ne maitrisent pas ces techniques et sont par voie de conséquence limités dans leur discours. Il y a un discours chez moi, mais après, il y a la pratique et la pratique, c’est la réalité de l’atelier. Je prends un tissus, je le projette sur un mannequin, je peux tout faire. Ce n’est pas de la fierté mal placée. J’ai cette capacité. Parce que j’ai été modéliste pendant longtemps et pour des gens très différents. J’ai fait des corsets pour certains, des maxi manteaux pour d’autres. J’ai appris à faire des choses très différentes.
Le cuir est très important pour toi. Comment envisages-tu l’utilisation du cuir alors que la consommation devient vegan ?
Je suis obligé de me plier. Je ne peux pas aller à contre courant. En sachant que les vegans remplacent le cuir par du simili cuir. C’est du plastique. Pour moi, c’est encore pire pour la planète. Quand je vois le désastre qu’est la culture du coton ! On peut parler de la laine aussi, des méthodes de tonte des moutons ! Les vers à soie aussi… L’industrie du textile et de l’habillement pollue énormément. Je trouve qu’il y a une certaine hypocrisie par rapport au cuir. L’autre jour j’écoutais une émission d’un médecin spécialiste en démologie (ensemble des sciences qui concernent le peuple et son environnement). Quand on a découvert les problèmes avec les élevages de visons au Danemark, ils ont du en tuer 18 millions pour limiter la propagation du coronavirus. Il a dit: “ces cultures intensives sont un vrai danger pour l’environnement“. C’est un argument que je peux entendre. Arrêtons ces élevages intensifs de bovins, de caprins… La question du textile n’est pas réglée. Le coton, la soie, la laine, on n’en parle pas assez. On n’a pas inventé de fibre qui puisse les remplacer. Je pense qu’actuellement, on est au milieu d’un vrai tremblement de terre.
Quelles seraient pour toi les pistes de développement durable?
D’abord, le recyclage. C’est une piste que je veux développer. J’ai commencé à le faire avec les kimonos et les foulards. Prendre des vêtements existants et les retravailler. Pour que ça marche, il faut conjuguer le passé (les vêtements existant) et le présent (la matière vierge). On peut aussi récupérer des stocks de matières. Mais il ne faut pas non plus se faire trop d’illusion, on va devoir relancer une économie. Si on n'achète plus de matières, on casse une industrie. Il y a un équilibre à trouver. Je n’ai pas la solution mais cela fait partie de mes recherches. Il y a aussi la dimension humaine. La machine à coudre par exemple, c’est la pire des choses qu’on ait pu inventer. Ça prend un temps fou ! Tu es là assis à pédaler… Pourtant j’adore ! Pour moi, c’est presque méditatif, mais quelqu’un qui fait ça toute la journée, qui ne fait que ça, c’est abrutissant. La machine à coudre a été inventée si ma mémoire est bonne en 1830 ou 32 et, à ce jour, on ne l’a pas faite évoluer. On a juste inventé un crochet pour la canette. C’est un outil tel qu’il a été inventé par Singer à l’origine, on l’utilise de la même façon. Ok, on a mis un moteur mais fondamentalement, elle n’a pas évolué tant que ça. Pour faire un vêtement, tu coupes et tu assembles. Plus il y a de coutures, plus il y a d’assemblage. J’ai réussi, en jouxtant les patrons, à ce qu’il y ait le moins de coutures possible. Mais malgré tout, ça prend un temps fou et ça a un coût énorme. Là, je suis en train de faire des pantalons. Faire des pantalons, c’est presqu’aussi long que de faire des vestes. Le prix du pantalon ne peut pas dépasser un tiers du prix de la veste parce qu’il ne porte pas sa valeur. Mais pour faire un beau pantalon, bien fini, que tu as envie de porter, avec de belles finitions à l’envers, ça prend du temps et ça ne se voit pas. On est actuellement entre deux mondes : le monde à venir n’existe pas encore et le monde révolu agonise. Quand j’étais en Espagne pendant mes études, mon maitre de thèse m’a fait travailler sur Vladimir Tatline, un plasticien de la révolution Bolchevique pour qui l’homme révolutionnaire après 1917 ne pouvait pas s’habiller comme à l’époque du tsar. Il a donc fait une recherche sur le vêtement. Il a pris une planche de coupe de veste de tailleur (je ne sais plus combien il y avait de morceaux) et il a assemblé tous les morceaux comme un kimono. Il y a aussi l’italien Thayaht, qui a fait la combinaison (TuTa) dans le mouvement futuriste. Tous ces hommes, dans cette période révolutionnaire, au début des années 20, avant que Staline arrive au pouvoir, ont participé à la période la plus productive de la révolution soviétique. J’ai l’impression qu’on traverse un moment similaire avec la pandémie, la crise économique, sociale, éthique. On a l’opportunité de mettre en place quelque chose de différent.
Dans tes vêtements, les notions de confort et d’habitabilité semblent très importantes, comment tu les définies?
Ce que j’ai retenu des vêtements d’Issey Miyake c’est que ce n’était pas le vêtement qui l’intéressait, ni le corps, mais l’espace entre le corps et le vêtement. J’aime qu’il y ait de l’espace entre le corps de la personne et le vêtement. C’est très important cette ampleur, cette manière dont le corps bouge d’un côté et le vêtement de l’autre, l’idée d’un vêtement ample qui ne va pas contraindre le corps. J’aime aussi les vêtements qui sont issus du langage militaire. Les manteaux qui sont de vraies carapaces, des protections, comme des tanks. Tu les portes pour te donner une vraie protection physique, une protection morale, sociale… Ils te donnent une attitude, une posture. Ce sont des abris, un habitat. Ça renvoie à ce que je disais au départ: associer architecture et vêtement. La tente est quelque chose qui m’intéresse également. Tu la roules, tu pars avec, tu t’installes ailleurs. C’est le vêtement du nomade. J’aime cette idée de vêtement et de personne en mouvement. Ce que je recherche lorsque je mets un vêtement sur le mannequin, c’est de retrouver l’idée de mouvement. Je n’aime pas les choses statiques, figées. Dans la construction d’un manteau, je crée le mouvement avec les lignes de couture qui parfois tournent en courbe ou en spirale. Ça crée une dynamique visuelle et on a l’impression que la manche va se plier naturellement, accompagner le bras avec aisance. L’idée de mouvement, de confort, c’est très important. Je déteste être gêné aux entournures.
Tu as une pièce favorite à part le kimono ?
Le manteau. Parce que c’est la pièce qui recouvre. C’est le toit. C’est la pièce qui vient par-dessus. Selon que tu la gardes ouverte ou fermée, tu dis des choses différentes. C’est une pièce que tu mets par-dessus un simple T-shirt ou avec une veste ou avec un pull… C’est la pièce qui m’impressionne le plus.
À quel niveau ?
Visuel. Les manteaux du soir en haute couture, par exemple, c’est très impressionnant. Ils ne servent qu’entre le moment où tu quittes la voiture et celui où tu arrives au vestiaire. Ils ont une durée d’utilisation très éphémère ! 15 mn au plus, selon la file d’attente à l’entrée de la soirée et peut être 30 à la sortie. Pourtant, c’est une pièce très forte. J’ai beaucoup étudié les dessins de mode des années 30-40-50, surtout ceux de l’illustrateur Eric dont j’adore le travail. Les manteaux du soir y ont un rôle capital. Maintenant on ne fait plus ça du tout. Le chic du chic, c’est d’enfiler un cardigan en laine, un manteau d’homme, un trench, sur une robe du soir. Ces codes sont révolus. Mais on n’a toujours pas réglé le problème de la chaussure à talon ! La grosse différence entre les hommes et les femmes, c’est que les femmes vivent la féminité, les hommes se contentent de la regarder. C’est très différent d’être acteur ou observateur. L’acteur sais dans son corps la contrainte que cela représente : marcher à petits pas, faire des gestes mesurés, ne jamais être assise avec certaines jupes, être toujours en posture de représentation… Un homme admire ça. La beauté féminine qui en ressort est magnifique mais on oublie la contrainte. Les femmes ne se rendent souvent même plus compte de la contrainte. Certaines ne sentent même pas les conséquences désastreuses d’un talon de 11 cm sur leur colonne vertébrale. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Au Brésil on dit que les piments dans le derrière des autres ne brulent pas. C’est très vulgaire mais très vrai. Jusqu’à il n’y a pas très longtemps, la mode était commandée par les hommes. Les femmes à la tête des maisons de mode, c’est très récent et beaucoup de femmes n’ont pas fait la révolution du plat. Sonia Rykiel avait des chaussures à talon compensé, donc hautes quand même, un peu japonaises. L’inversion des rôles est très récente dans l’histoire du costume. Je comprends qu’il y ait une résistance énorme par rapport à ça. Ça renvoie à une idée de la femme soumise aux hommes. Et il faut en tenir compte maintenant.
Peut-être faut-il s’en remettre à l’interprétation des clients ?
Quand on fait un projet d’architecture, on reconnait la patte de l’architecte mais c’est l’usager, l’habitant, qui va donner à cette maison une personnalité. Je me positionne encore comme un architecte. Ça synthétise tout ce que je dis. C’est pour ça que si je fais de la broderie, je la ferai comme un ornement, comme en architecture. Ce ne sera pas de la décoration. La décoration, c’est la personne qui occupe la maison qui la choisit : les tableaux, les meubles, les miroirs…. L’architecte crée un cadre d’ombre et de lumière, mais son rôle est celui d’un relai. C’est un truc que j’ai bien appris quand j’étais nageur. Dans mon métier aussi, c’est une histoire de relai. Une fois que les vêtements sont faits, la boutique l’interprète en créant des silhouettes pour sa vitrine, ou encore la rédactrice de mode qui va mettre en scène les photos pour son magazine, ou même l’influenceuse qui va les porter sur son compte Instagram. Ce n’est plus moi, ça ne m’appartient plus. Je crois avoir vraiment cette humilité. Je n’ai pas la prétention d’être présent jusqu’au bout de la chaine. Les grandes marques vendent des silhouettes de la tête aux pieds, y compris la palette de maquillage. Je n’ai jamais cru à ça. Le truc qui m’a plu quand j’ai commencé à faire ce métier, c’est quand les boutiques multi marques me disaient avec qui ils me présentaient. “On te met à côté de Rick Owens, de Carol Christian Poell, d’Ann Demeleumeester… ça marche très bien parce qu’on peut mélanger“. J’ai toujours aimé cette ouverture, cette proximité. J’ai presqu’envie de ne pas travailler des thèmes complets, de toujours laisser une brèche pour q’une marque complémentaire vienne se greffer. Et pour que la personne qui vient nous acheter se sente libre de mélanger avec d’autres pièces. J’espère que ce sera ça le monde d’après, une ouverture, de la diversité.